En quelques mots
Syncrétisme agro-écologique : revitaliser les vestiges et lacs en friche des anciennes gravières le long de la Garonne
Les anciennes gravières de la Garonne, laissées en friche après des décennies d’exploitation, sont aujourd’hui des espaces dégradés : sols appauvris, eaux altérées, nappe phréatique exposée. Pourtant, ces terrains offrent une opportunité unique : celle de transformer ces vestiges industriels en refuges de biodiversité et en espaces agricoles durables. Ce projet propose une solution inspirée des chinampas, ces parcelles agricoles flottantes développées par les civilisations mésoaméricaines, pour restaurer ces milieux et les rendre productifs. L’objectif : revitaliser les sols, améliorer la qualité de l’eau et créer un modèle d’agriculture résiliente adapté aux zones humides dégradées. En phase avec les politiques environnementales françaises et les enjeux de la Stratégie Nationale Biodiversité, cette recherche apporte des solutions concrètes et réplicables pour repenser l’avenir des sites post-extraction. Financer cette initiative, c’est investir dans un projet innovant où l’architecture et l’agroécologie se rencontrent pour façonner un territoire plus équitable, productif et engagé.
Impacts sociétaux
- Indicateur de suivi (de la biodiversité)
- Meilleure connaissance d’un milieu, d’un processus…
- Méthodologie de restauration
Porteur du projet
Structure

LRA (Laboratoire de Rechercher en Architecture – attaché à l’École Nationale Supérieure de Toulouse)
LRA & ENSA Toulouse – 83 rue Aristide Maillol BP 10629 31106 Toulouse cedex 1 – France
Axes de recherche
Le Laboratoire de recherche en architecture (LRA) axe concrètement ses recherches sur l’explicitation approfondie du processus de projet architectural, urbain et paysager sur le long terme. Cela se traduit par une investigation des modalités cognitives et méthodologiques inhérentes à ce processus. Concrètement, les chercheurs du LRA s’intéressent à la manière dont les architectes, urbanistes et paysagistes utilisent des références, des modèles, des techniques et des enseignements heuristiques dans leur travail de conception. Il s’agit de comprendre les mécanismes intellectuels et les outils employés pour développer un projet, depuis sa conception initiale jusqu’à sa réalisation et au-delà. Un autre axe de recherche fondamental est le recentrage de la recherche sur la maîtrise du projet architectural et urbain. Cela implique une volonté de comprendre et d’améliorer les méthodes et les savoir-faire spécifiques à la conception architecturale et urbaine. Le LRA cherche à développer une recherche moins dépendante des disciplines habituellement convoquées comme la sociologie ou l’histoire lorsqu’il s’agit d’étudier l’architecture. L’objectif est de construire des fondements propres à la recherche architecturale, urbaine et paysagère, en développant un langage commun qui transcende les jargons disciplinaires. Le laboratoire s’efforce également de réduire les écarts entre les approches dites théoriques et/ou fondamentales et les approches réalistes et opératoires des projets architecturaux, urbains et paysagers. Concrètement, cela signifie que la recherche menée au LRA ne se limite pas à la théorie, mais cherche également à avoir une application concrète dans la pratique du projet. Les chercheurs sont soucieux de produire des connaissances qui soient utiles par et pour les acteurs de projets architecturaux et urbains à toutes les étapes : aide à la décision, programmation, conception, faisabilité, réalisation, utilisation, réception, réhabilitation, et déconstruction. La recherche au LRA se caractérise par un spectre disciplinaire très large, reconnaissant la complexité et la transversalité des enjeux liés au projet architectural et urbain. Cette approche multi-scalaire est également un élément concret de leurs axes de recherche. Enfin, une dimension importante des axes de recherche du LRA est l’ouverture internationale. Le laboratoire s’engage dans des échanges scientifiques internationaux, notamment à travers des actions phares en lien avec la politique internationale de l’ENSA de Toulouse au Vietnam, en Asie du sud-est, au Brésil, en Amérique latine, en Inde, au Maroc et en Afrique du nord et de l’ouest. Cette collaboration internationale enrichit les perspectives et permet de confronter différentes approches du processus de projet architectural et urbain.
Équipe
Tutorat
Luc GWIAZDZINSKI, HDR Géographe – Professeur ENSA Toulouse, rattaché à l’ED TESC. Chercheur permanent LRA
Parcours et expertise
Luc Gwiazdzinski est actuellement Professeur à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse (ENSA) depuis 2020 et est rattaché à l’ED TESC. Il est également chercheur permanent au Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA) de cette même institution. Son parcours académique est solidement ancré en géographie, puisqu’il est Docteur en géographie de l’Université de Strasbourg et possède une HDR (Habilitation à diriger des recherches) de l’Université Grenoble-Alpes. Ses précédentes responsabilités universitaires témoignent de son engagement dans l’enseignement et la recherche :• Directeur de l’Institut de géographie alpine (UGA, Grenoble) en 2015-2016.• Directeur du master « Innovation et territoire » (UGA) de 2011 à 2019.• Chargé de mission MSHAlpes, Cycle de conférences « RV en sciences humaines » de 2012 à 2017.• Maître de conférences (HC) urbanisme et aménagement de l’espace à l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine (UGA, Grenoble) de 2007 à 2020.• Vice-président adjoint UJF, « Valorisation et innovation territoriale » de 2008 à 2010.• Professeur associé à l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) de 2002 à 2007.• Professeur associé géographie et aménagement à l’ULP (Strasbourg) de 1996 à 2002. Son domaine d’expertise principal se situe en géographie, mais avec une spécialisation très poussée et reconnue sur les thématiques de la ville, de la métropolisation, du temps, des rythmes, de la nuit, des mobilités et de la géographie situationnelle. Ses travaux de recherche explorent ces axes de manière approfondie, comme en témoignent les titres de ses nombreuses publications et les thèmes des colloques et programmes de recherche qu’il a dirigés.Plus spécifiquement :• Il a consacré une part importante de ses recherches à la nuit, explorant ses dimensions urbaines, sociales et temporelles, comme l’indiquent ses ouvrages « La ville 24h/24 », « La nuit dernière frontière de la ville », et « Night studies ». Il a également publié de nombreux articles et chapitres sur ce thème, tels que « Ce que la nuit raconte au jour. Vers une approche nuitale des mondes urbains » et « La nuit comme bien commun de l’humanité. Vers un urbanisme des liens et des médiations ».• La question du temps et des rythmes dans les territoires est un autre pilier de son expertise, comme en témoignent son « Manifeste pour une politique des rythmes » et l’ouvrage « Rythme et flux à l’épreuve des territoires » qu’il a dirigé. Il a également abordé ces thèmes dans des articles tels que « Rythmes de vie (s), rythmes de ville (s ). Promesses d’un concept en mouvement ».• Ses travaux sur les mobilités explorent les dynamiques des déplacements dans la ville, y compris la nuit, comme le suggèrent son implication dans l’étude des services de mobilités nocturnes et son article « Des méthodes et des outils au service d’une nouvelle intelligence des mobilités ».• La métropolisation est un contexte fondamental de ses recherches, qu’il aborde en lien avec les questions de temps, de rythmes et de nuit, comme le montrent des titres tels que « Face aux nouveaux régimes temporels métropolitains. Les pistes du chrono-urbanisme pour une ville malléable ».• Il s’intéresse également aux formes émergentes de l’action collective et de la politisation dans l’espace public, comme l’illustre son ouvrage « Sur la vague jaune. L’utopie d’un rond-point » et ses articles sur le rond-point des gilets jaunes.• Plus récemment, il a développé le concept de territoires apprenants, explorant les processus d’apprentissage émergents à l’épreuve du réel, comme en témoigne l’ouvrage « Territoires apprenants. Un processus d’apprentissage émergent à l’épreuve du réel » qu’il a co-dirigé. Son expertise se manifeste également par sa direction de la collection « l’innovation autrement » aux éditions Elya, qui publie des ouvrages explorant de nouvelles perspectives sur les territoires et les mobilités. Enfin, sa participation à de nombreux colloques, séminaires et conférences ainsi que ses nombreuses interviews dans la presse et les médias témoignent de son rôle actif dans la diffusion de ses travaux et son influence dans les débats contemporains sur la ville et les territoires.
Candidat·e
Edgar VELA PALLARES
Parcours
Edgar Vela présente un parcours académique orienté vers l’architecture, culminant avec l’obtention du diplôme d’Architecte D.E.A. de l’ENSA Toulouse en 2024, distingué par une double mention, dont une mention spéciale du jury pour son Projet de Fin d’Études portant sur la réhabilitation des terres agricoles dans la métropole toulousaine et une Mention Recherche. Son domaine d’expertise en devenir, tel qu’explicitité par sa recherche actuelle de thèse de doctorat en architecture (2024 – en cours) intitulée « Syncrétisme agroécologique : revitalisation des vestiges et des lacs résiduels des gravières dans le lit majeur de la Garonne », s’inscrit dans une démarche exploratoire du syncrétisme agroécologique et de la revitalisation des écosystèmes dégradés par l’extraction de granulats. Ce champ d’investigation est préparé par ses mémoires de Master, traitant de la résilience urbaine et de la valorisation des lacs résiduels des carrières et des perspectives des FLOSS dans le BIM, témoignant d’un intérêt pour les enjeux environnementaux et les outils numériques en architecture. Son expérience professionnelle en tant que Collaborateur Architecte et ses stages, notamment dans une agence spécialisée dans le patrimoine architectural, enrichissent son profil par une expérience pratique de la conception et de l’aménagement d’espaces et une sensibilisation aux problématiques de la réhabilitation. Ses compétences linguistiques et informatiques, incluant la maîtrise de logiciels BIM et de modélisation, ainsi que sa participation à des workshops internationaux axés sur l’urbanisme, le paysage, l’écologie et la durabilité, complètent son profil de chercheur engagé et multidisciplinaire.
Présentation du projet
#Mutation des territoires
# réhabilitation écologique
# écologie des sols
# infrastructures vertes
# paysages post-extractivisme
# écosystèmes lacustres
# prospective territoriale.
Descriptif


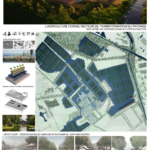
Jeux de données prévus, étude de terrain prévue
Pour l’étude, plusieurs jeux de données sont prévus, tandis que d’autres pourraient être manquants ou nécessiteront d’être collectés. Une étude de terrain est effectivement prévue.Jeux de données prévus ou existants :• Données bibliographiques et état de l’art : Une analyse des stratégies existantes en matière de reconversion des sites post-extractifs et une bibliographie analytique sur la réhabilitation des carrières et l’agriculture en milieux humides sont prévues. La revue de littérature portera notamment sur la gestion durable des sols, la réhabilitation des carrières, les chinampas et l’agroécologie.• Données territoriales et contextuelles : Des données sur la plaine alluviale de la Garonne à Saint-Caprais, incluant les sols, les habitats aquatiques et terrestres, et l’exposition de la nappe phréatique, sont déjà identifiées à travers des références bibliographiques existantes. L’analyse de l’évolution historique du territoire, incluant les interactions socio-économiques et les perturbations territoriales, est considérée essentielle.• Données hydrologiques et pédologiques : La collecte de données hydrologiques et pédologiques sur les sites d’étude est explicitement mentionnée.• Données socio-économiques : Le projet cherche à mesurer l’impact socio-économique des réhabilitations.• Données cartographiques et spatiales : La cartographie des lacs résiduels et l’analyse des dynamiques spatiales par la cartographie des interactions entre hydrologie, agriculture et infrastructures bâties sont prévues. L’intégration de compétences en cartographie et modélisation spatiale du Laboratoire de Recherche en Architecture (LRA) est également mentionnée. L’utilisation de données géographiques est soulignée dans le cadre de l’intelligence territoriale.• Données sur les pratiques de réaménagement : Le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Garonne est mentionné comme une source d’exemples de réaménagement.Jeux de données potentiellement manquants ou à approfondir :• Bien que des références bibliographiques soient citées concernant la dégradation des sols et des eaux, des données spécifiques et actualisées sur la qualité des sols et de l’eau des sites étudiés pourraient être nécessaires et collectées lors des études de terrain.• Des données détaillées sur l’exploitation des granulats (historique précis, volumes extraits, techniques utilisées) pourraient être manquantes et nécessiteraient des échanges avec les entreprises concernées.• Une analyse plus approfondie des dynamiques socio-économiques locales et des perceptions des acteurs locaux (au-delà des entretiens prévus) pourrait être nécessaire. La phase d’observation pour la collecte des données sur la mémoire collective est avancée mais non achevée.Étude de terrain prévue :Une étude de terrain est absolument prévue et constitue une part essentielle de la méthodologie. Elle comprendra :• Campagnes d’observation sur plusieurs sites de lacs résiduels.• Rencontres et entretiens avec les agriculteurs, les urbanistes, les collectivités, les experts en agroécologie et potentiellement les exploitants de carrières.• Collecte de données hydrologiques et pédologiques.• Mise en place de parcelles expérimentales pour tester différentes techniques agricoles et hydrologiques.• Conception de prototypes architecturaux adaptés aux milieux humides.• Relevés écologiques.• Un séjour de recherche à Mexico est également prévu pour une étude comparative des chinampas.L’étude de terrain permettra de nourrir les expérimentations, la modélisation et l’analyse des dynamiques spatiales et temporelles des sites étudiés.
Programme de recherche
Le mot de Proches
1

